Sous l’Ancien Régime, quelles sont les décisions royales qui réglementent la vie familiale de nos ancêtres ?
Sous l’Ancien Régime, à l’échelle du royaume, le pouvoir central s’occupe progressivement de domaines qui parfois encore échappaient à sa compétence (famille, droit privé, hôpitaux...). Ainsi, au cours des siècles, à plusieurs reprises, l’Etat intervient directement dans le domaine social et notamment sur la législation relative à la famille. Petit tour d’horizon des édits, ordonnances et arrêts qui agissent sur la vie quotidienne de nos ancêtres :
1) Les mesures sur la constitution de l’état civil :
- En 1539, ordonnance de Villers-Cotterêts : les curés doivent tenir des registres de décès afin de contrôler la vacance des bénéfices [1], et des registres des baptêmes pour mieux vérifier la majorité. Les registres doivent être déposés chaque année au greffe du bailli ou sénéchal royal (série E des AD).
| Art. 51 : « Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foy à cette fin. » |
- En 1563, l’édit d’Amboise reconnaît aux protestants la liberté de faire baptiser leurs enfants par les ministres de leur culte.
| À noter que la même année, un des canons du concile de Trente oblige les curés à tenir un registre des baptêmes avec mention des parrains et des marraines, car ceux-ci ne peuvent épouser leurs filleuls. Le mariage devient un acte solennel avec présence d’un prêtre et célébration publique. Pour éviter la bigamie, l’époux étranger à la paroisse doit présenter une autorisation de célébration rédigée par le curé de sa paroisse. Les évêques peuvent désormais délivrer des dispenses nécessaires pour le mariage des cousins au 3e degré (enfants de cousins germains) et au 4e degré (petits-enfants de cousins germains). Le Saint-Siège continue à délivrer les dispenses entre oncle et nièce et entre cousins germains. |
- En 1579, ordonnance de Blois : elle impose aux curés de tenir des registres des baptêmes, mariages et sépultures ainsi que leur dépôt annuel au greffe du tribunal royal le plus proche.
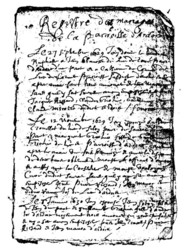
- En 1664, les pasteurs reçoivent officiellement la mission de tenir l’état civil des protestants.
- En 1667, une ordonnance civile fait obligation aux curés de tenir régulièrement les registres paroissiaux en deux exemplaires (la minute, qui reste chez le curé, et la grosse qui est déposée au greffe). Le texte impose la signature des actes de baptême par les parrains et marraines, des actes de mariage par les conjoints et les témoins (avec indication des parentés), des actes de sépulture par deux parents ou deux amis présents. L’âge, parfois la date de naissance ou les indications de majorité et minorité des conjoints, la profession et le domicile des conjoints et des parents deviennent obligatoires dans les actes de mariage ainsi que la date de décès dans les actes de sépultures.
- En 1685, avec l’Edit de Fontainebleau, le roi révoque celui de Nantes (1598). Les baptêmes des protestants doivent être inscrits dans les registres paroissiaux catholiques (ou dans des registres protestants clandestins). Les protestants, qui ne peuvent se marier dans leur religion, ont parfois recours au concubinage (cf. les contrats de mariage protestants dans les actes notariés) ou au mariage à l’étranger. Les décès de protestants doivent être déclarés par deux témoins au juge royal ou seigneurial le plus proche.
- En 1698, une déclaration royale rappelle l’obligation du baptême le jour de la naissance ou le lendemain au plus tard.
- En 1736, le chancelier d’Aguesseau prescrit aux curés de tenir les registres paroissiaux en deux exemplaires signés par les parties, puis de déposer un exemplaire au greffe du tribunal. « La qualité de la personne décédée » et la mention de sa profession deviennent obligatoires dans les actes de sépultures. Les qualités, professions, domiciles et liens des témoins de mariage avec les conjoints deviennent aussi obligatoires. Des registres spéciaux sont ouverts pour les sépultures protestantes. A partir de cette date, la bonne tenue des registres paroissiaux s’affirme dans tout le royaume.
| Article premier : « Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures, qui se feront dans le cours de chaque année, l’un desquels continuera d’être tenu sur du papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, et l’autre sera en papier commun, et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année. » |
- En 1746, un arrêt prescrit la tenue de registres paroissiaux séparés (sépultures, baptêmes & mariages).
- En 1787, Louis XVI fait un pas dans la voie de la tolérance en accordant l’état civil aux protestants... mais pas la liberté de culte. Ils redeviennent ainsi des sujets à part entière. Les déclarations sont faites devant le juge civil ou devant le curé, mais les funérailles se font dans un cimetière particulier et elles doivent rester discrètes. Les mariages antérieurs et les enfants qui en sont nés peuvent être légitimés devant le juge (cf. les réhabilitations).
2) La protection du « part » (de l’enfant) :
- En 1556, l’infanticide et l’avortement sont assimilés à un homicide et un édit déclare coupable et passible de la peine de mort la femme qui n’aurait pas antérieurement déclaré sa grossesse ou son accouchement au curé ou à un juge. De simples témoignages suffiront pour condamner la fautive. Son enfant sera privé du baptême et de la sépulture chrétienne. Un autre but de l’édit est de permettre l’identification du père afin qu’il puisse assumer sa charge. Cet édit est lu quatre fois l’an au prône [2] de la messe paroissiale (cf. les déclarations de grossesses dans les séries B et U des AD) (cf. 1586).
- En 1586, l’édit de 1556 sur les déclarations de grossesses est renouvelé.
| Vers 1638-1640, pour remédier à la déplorable situation des enfants abandonnés, Vincent de Paul et les filles de la Charité fondent l’Oeuvre des Enfants trouvés. |
| À partir de 1650, multiplication des conceptions prénuptiales (cf. les registres paroissiaux). Dans la seconde moitié du XVII° siècle, pour contourner les mesures prises contre les mariages clandestins, non solennels, la pratique du mariage à la Gaulmine se répand dans la population (selon l’exemple de Gilbert Gaulmin) : tirant prétexte du fait que le curé n’est chargé canoniquement que de recevoir le consentement des intéressés, ceux-ci se présentent avec deux notaires devant le prêtre. Ces derniers enregistrent le refus du curé de célébrer l’union et la volonté des futurs époux de se marier. L’exigence de la publicité, des témoins et de la présence du curé étant ainsi respectée, l’Eglise ne peut que reconnaître la validité de ces mariages... mais pas le Parlement qui les annule. |
- À la fin du XVII° siècle, des initiatives locales, religieuses ou étatiques, tentent d’enrayer les diverses pratiques les plus courantes de l’infanticide. Pour éviter les décès d’enfants en bas âge par suffocations et oppressions, il est parfois interdit aux parents de dormir avec leur bébé dans le lit conjugal.

- Le nouveau-né, détail d’après l’adoration des bergers par G. de la Tour, 1645.
- En 1708, le roi rappelle l’obligation de déclaration de grossesse pour les filles non mariées ou veuves. A cette occasion, l’édit de 1556 est à nouveau lu au prône de la messe paroissiale.
- En mai 1740, l’édit de 1556 est à nouveau lu au prône de la messe paroissiale. De plus, depuis 1739, les mères indignes risquent une amende de 100 francs par enfants abandonnés. La profession de nourrice est aussi réglementée, car près de la moitié des enfants placés en nourrice meurent par négligence. Leur faible salaire mensuel (7 livres) oblige les nourrices à garder ensemble au moins une dizaine d’enfants. Désormais, placées sous le contrôle des lieutenants de police en ville et du curé à la campagne, elles doivent déclarer leurs grossesses et elles ne peuvent allaiter et élever plus de deux nourrissons à la fois, sous peine d’amende pour leur mari et du fouet pour elles-mêmes.
- En 1772, un décret prescrit la tenue de registres des déclarations de grossesses (série B des AD).
3) Les mesures sur le mariage :
- Un édit de 1556 déshérite et met hors la loi les enfants de la haute noblesse qui se marient sans le consentement de leurs parents (mariages clandestins [3]).
- En 1557, une ordonnance condamne à mort les coupables de « rapt de séduction ». La même année, selon un édit, Les hommes âgés de moins de 30 ans et les femmes âgées de moins de 25 ans qui auraient contracté des unions clandestines peuvent être déshérités (cf. 1639 ci-dessous).

- L’Accordée de Village, tableau de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805)
- En 1579, ordonnance de Blois : pour lutter contre le rapt de séduction et les mariages clandestins, dus au refus d’autorisation des parents, la législation ordonne la publication de trois bans au prône des messes des trois dimanches précédant le mariage et la présence de quatre témoins à la cérémonie. La peine de mort est prévue pour ceux qui détournent des mineurs « sous prétexte de mariage ou autre couleur ». Par ailleurs, les curés ont l’obligation de ne pas célébrer les mariages des mineurs qui n’ont pas l’autorisation de leurs parents et ces derniers peuvent déshériter leur enfant marié clandestinement (début de la montée de la puissance paternelle et des unions calculées par les familles, des alliances d’intérêts en fonction du contexte social). La bigamie, les mariages consanguins et les répudiations d’épouses sont également dénoncés. Progressivement, selon les régions, les curés se mettent à tenir ces registres, surtout dans la partie nord du royaume. Cet édit sera repris en 1697.
| Au début du XVII° siècle, instauration de la sommation respectueuse : il s’agit d’une procédure qui permet aux filles de plus de 25 ans et aux garçons de plus de 30 ans de se passer du consentement de leurs parents à leur mariage. La requête est rédigée par un notaire ou un avocat auprès du lieutenant général de la sénéchaussée. Le procureur, accompagné de 2 témoins, se rend ensuite chez les parents des jeunes gens pour effectuer trois sommations. Le plus souvent, sous la pression indirecte du village, les parents récalcitrants finissent par céder à la demande de leurs enfants. (séries B et E des AD). |
- En 1639, l’édit de 1557 est répété : Depuis le Concile de Trente, les mariages sont réglementés : une publication de trois bans, la présence d’un prêtre et de quatre témoins sont nécessaires. Mais les mariages clandestins restent nombreux et de nombreux couples se contentent d’un notaire ou d’un curé complaisant pour entendre leur consentement. Une ordonnance de novembre 1639 entend supprimer cette coutume.
- À partir de 1692, la mention des dispenses de parenté devient obligatoire dans les actes de mariage.
| Selon Anne Fillon, c’est dans la première moitié du XVIII° siècle que la formation du couple et notamment l’officialisation de la fréquentation font désormais l’objet d’un cérémonial : des cadeaux, dont notamment une bague, remplacent la pièce d’argent autrefois offerte en arrhes devant le père de la promise (cf. les contrats de mariage, très nombreux au XVIIIe siècle, souvent rédigés dans la même journée que le mariage, et qui montrent la tendance à l’égalité des apports des deux futurs époux). |
Source :
Thierry Sabot,
Contexte, guide chrono-thématique, Roanne, 2007.